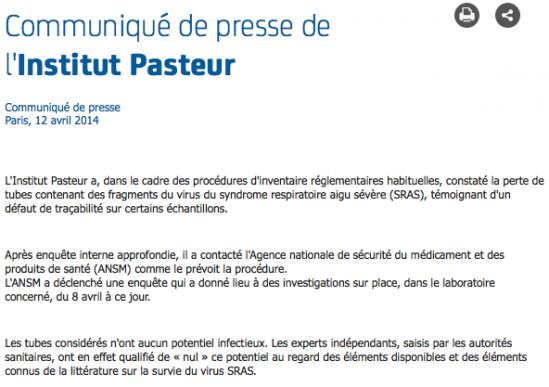
Les dangers sur la santé publique que posent des virus pandémiques, dans le cas où ils s’échapperaient de leurs laboratoires, sont au cœur de bon nombre de débats actuels, du fait notamment d’expériences menées sur des souches hyperactives (des mutations dites à « gain de fonction »). L’objectif manifeste de ces recherches –dans lesquelles des scientifiques manipulent des pathogènes déjà dangereux afin de créer ou d’augmenter leur contagiosité parmi les humains– est le développement d’outils visant à surveiller l’émergence naturelle de souches pandémiques. Du côté de leurs détracteurs, qui s’expriment dans une série de récentes publications scientifiques, le temps est aux mises en garde : les menaces que font planer ces pathogènes à haut-risque dépasseraient, et de loin, tous les bénéfices qu’il est possible d’en tirer.
Le danger d’une pandémie artificielle, causée par une fuite de laboratoire, n’a rien d’hypothétique : on en a connu une en 1977, survenue parce que des scientifiques craignaient l’imminence d’une pandémie naturelle. D’autres fuites de laboratoires, concernant des pathogènes à haut-risque, ont été à l’origine de contagions dépassant le simple personnel des laboratoires concernés. L’ironie de la chose, c’est que ces établissements travaillaient sur ces pathogènes dans le but de prévenir les épidémies qu’ils allaient eux-mêmes provoquer. Leurs conséquences tragiques ont donc souvent été qualifiées de « prophéties auto-réalisatrices ».
Grâce aux analyses génétiques modernes, il est possible d’identifier précisément les pathogènes. Vu que tous les pathogènes en circulation subissent des modifications génétiques au cours du temps, l’année d’émergence d’un pathogène spécifique peut, en général, être déterminée, car les bases de données stockant des agents biologiques contiennent suffisamment d’échantillons. Ce qui fait que, si un pathogène apparaît dans la nature sans y avoir auparavant circulé pendant plusieurs années, voire plusieurs décennies, on peut soupçonner qu’il s’est échappé d’un laboratoire. Un laboratoire qui l’a stocké dans sa forme inerte pendant un certain temps et sans la moindre accumulation de modifications génétiques –l’équivalent, en d’autres termes, du gel de son évolution naturelle.
1976-1977| La terreur de la grippe porcine et la pandémie de grippe humaine H1N1
La souche de grippe humaine H1N1 est apparue avec la pandémie mondiale de 1918 pour, lentement, accumuler ensuite de légères modifications génétiques, et ce jusqu’en 1957, où elle fut considérée comme disparue après l’émergence du virus pandémique H2N2.
En 1976, une souche de grippe porcine s’abat sur Fort Dix, dans le New Jersey, causant 13 hospitalisations et un décès. Le spectre d’une reprise de l’épidémie mortelle de 1918 fait alors son apparition et suscite un programme de vaccination d’une ampleur inédite –le but est de protéger tous les Américains. Pour autant, aucune pandémie d’H1N1 ne se concrétise et le programme de vaccination doit être arrêté après 48 millions d’individus traités, et 25 morts directement imputables aux injections.
Le virus H1N1 humain réapparaît en 1977, en Union soviétique et en Chine. Des virologistes, se fondant sur des tests sérologiques et génétiques précoces, suspectent rapidement une fuite de laboratoire pour un virus datant de 1949-1950. Des soupçons ensuite confirmés grâce aux progrès des techniques de génomique.
En 2010, cette confirmation devient un fait scientifique : « Le cas le plus célèbre d’une souche virale échappée d’un laboratoire concerne la ré-émergence de la grippe A H1N1, observée pour la première fois en Chine en mai 1977, et quelques temps après en Russie », affirment des chercheurs. Le virus a sans doute fuité d’un laboratoire qui préparait un vaccin à base d’une souche atténuée de H1N1, et ce pour répondre à l’alerte déclenchée par la pandémie américaine de grippe porcine.
La pandémie de 1977 s’est rapidement propagée dans le monde, tout en se cantonnant globalement aux individus de moins de 20 ans : les personnes plus âgées étaient immunisées grâce à des expositions antérieures à 1957. Son taux d’attaque est alors assez élevé (entre 20% et 70%) dans des écoles et des casernes militaires, mais le virus ne cause heureusement que des troubles modérés et très peu de morts. Le pathogène continue à circuler jusqu’en 2009, date à laquelle la souche pH1N1 le remplace.
Aujourd’hui, le grand public demeure quasiment ignorant des origines laborantines de la « grippe russe » de 1977, et ce malgré une analogie évidente avec les craintes que peuvent susciter d’éventuelles pandémies de grippe aviaire H5N1 ou H7N9, et d’autres expériences à « gain de fonction ». Les conséquences d’une fuite d’un virus aviaire extrêmement létal, doté d’une contagiosité accrue, seraient à l’évidence bien plus graves que la fuite de 1977, qui ne concernait qu’une souche « saisonnière » et sans doute atténuée, et une population majoritairement immunisée.
Années 1970 | Fuites de variole en Grande-Bretagne
L’éradication de la variole naturelle et de sa transmission a rendu intolérable l’éventualité d’une réintroduction du virus. Un risque qui s’est clairement manifesté au Royaume-Uni.
Entre 1963 et 1978, le Royaume-Uni n’a connu que quatre cas de variole (sans aucun décès), importés par des voyageurs en provenance de zones où la maladie était endémique. Mais, pendant la même période, on a dénombré au moins 80 cas et 3 morts, causés par trois fuites, de deux laboratoires différents.
La première fuite officiellement reconnue, datant de mars 1972, survient après l’infection d’une assistante de laboratoire à la London School of Hygiene and Tropical Medicine. Elle venait d’observer la récolte de souches virales vivantes et contenues dans des œufs, utilisés comme milieu de culture ; le processus s’est fait sur une paillasse non-confinée, comme il est d’usage à l’époque. Elle est hospitalisée, mais avant d’être placée en isolement septique, contamine deux personnes venues rendre visite au patient qui partage alors sa chambre –les deux meurent. Auparavant, ils contaminent une infirmière, qui survit, tout comme l’assistante de laboratoire.
En août 1978, une photographe médicale de la Birmingham Medical School attrape la variole et meurt. Elle contamine sa mère, qui survit. Son studio était situé juste au-dessus du laboratoire de la Birmingham Medical School, où étaient stockées les souches virales. L’accident est imputé à une mauvaise ventilation et des problèmes techniques.
Ce qui pousse des enquêteurs à réexaminer un cas très similaire de contagion variolique, survenu en 1966. Le premier malade était aussi un photographe médical, travaillant dans le même bâtiment de la Birmingham Medical School.
Cette fois-ci, l’épidémie concernait une souche peu virulente de variole (variola minor) et contamina au moins 72 autres personnes. Aucun décès ne fut à déplorer. Les rapports d’activité du laboratoire finirent par révéler qu’une manipulation de variola minor avait bien été effectuée à un moment pouvant correspondre à l’infection du photographe, travaillant à l’étage du dessus.
1995 | Encéphalite équine vénézuélienne
L’encéphalite équine vénézuélienne est une maladie virale transmise par des moustiques. Régulièrement, elle provoque des épidémies d’ampleur régionale ou continentale touchant des espèces équines (chevaux, ânes, mulets) sur le continent américain et dans les Caraïbes. Les poussées s’accompagnent souvent d’épidémies zoonotiques chez les humains.
Chez l’homme, l’EEV se traduit par de fortes fièvres ; elle est occasionnellement mortelle, mais peut laisser des séquelles neurologiques permanentes (épilepsie, paralysie, retard mental) dans 4% à 14% des cas cliniques, notamment quand ils concernent des enfants.
Entre les années 1930 et 1970, on dénombre quelques épidémies significatives d’EEV, survenant à intervalle à peu près régulier. Des analyses contemporaines ont ensuite révélé que la plupart de ces épidémies ont été causées par des souches génétiquement proches de celle de 1938, isolée et inactivée pour être utilisée dans des vaccins vétérinaires. A l’évidence, plusieurs lots de vaccins n’avaient pas été correctement inactivés et gardaient des traces de contaminants.
Entre 1938 et 1978, la majorité des épidémies d’EEV est imputable au vaccin qui était censé les éviter, un exemple manifeste de prophétie auto-réalisatrice.
En 1995, une épidémie majeure d’EEV, animale et humaine, s’abat sur le Venezuela et la Colombie. Elle provoque a minima 10.000 infections humaines, avec 11 morts au Venezuela, et touche environ 75.000 personnes en Colombie, dont 3.000 souffrant de complications neurologiques et 300 décès. Ce virus est isolé sur 10 cadavres de fœtus morts-nés ou issus de fausses-couches.
Des analyses génomiques déterminent que le virus de 1995 est identique à une souche de 1963, sans la moindre indication de circulation naturelle pendant 28 ans. Encore un cas d’évolution gelée, mais contrairement aux épidémies liées à la souche de 1938, le virus de 1963 ne s’est jamais retrouvé dans un vaccin.
Les doutes s’orientent donc sur une fuite de laboratoire, soit via une infection non déclarée d’un employé ou d’un visiteur, soit via l’infection d’un animal de laboratoire, voire d’un moustique. En 2001, un groupe formé des plus éminents scientifiques travaillant sur l’EEV publie un article affirmant que l’épidémie de 1995 est sans doute imputable à une fuite de laboratoire et citant des preuves circonstancielles : la souche responsable de l’épidémie a été isolée dans une préparation antigénique partiellement inactivée et utilisée sans protection dans un laboratoire situé près du foyer de l’épidémie. Mais, sans preuves plus solides, le groupe déclare par la suite devoir réévaluer cette conclusion.
Années 2000 | Flambées de Sras, après l’épidémie principale
En 2003, le Syndrome respiratoire aigu sévère se propage à 29 pays, causant 8.000 infections et au moins 774 morts. Comme 21% des cas concernent du personnel hospitalier, le virus est susceptible d’annihiler les services de santé des zones touchées. Il est particulièrement dangereux à manipuler en laboratoire, car il n’existe pas de vaccin et que sa transmission peut se faire par aérosols.
En outre, 5% des malades du Sras sont des « super-transmetteurs », capables de causer au moins 8 cas secondaires. Par exemple, un patient aura directement transmis le Sras à 33 autres (ce qui relève d’un taux d’infection de 45%) pendant une hospitalisation, ce qui, au final, se soldera par la contagion de 77 personnes, dont 3 super-transmetteurs secondaires. Il suffit donc d’un seul super-transmetteur pour transformer une infection de laboratoire en potentielle pandémie.
Le Sras n’a pas réémergé naturellement, mais on dénombre 6 fuites de laboratoires de virologie : une à Singapour et une à Taïwan, et quatre dans un même laboratoire de Pékin.
La première fuite survient en août 2003, à Singapour, via un étudiant de troisième cycle en virologie de l’Université nationale de Singapour. Il ne travaille pas directement en contact avec le Sras, mais le virus est présent dans son laboratoire. Il guérit et ne cause aucun cas secondaire. L’OMS forme alors un comité d’experts pour réviser les procédures de bio-sécurité liées au Sras.
La seconde fuite se déroule à Taïwan, en décembre 2003, lorsqu’un chercheur tombe malade dans l’avion qui le ramène d’un séminaire médical organisé à Singapour. Les 74 personnes avec qui il est entré en contact à Singapour sont placées en quarantaine mais, encore une fois et heureusement, personne n’est infecté par le Sras. Les rapports d’enquête révèlent que le scientifique avait manipulé des déchets biologiques mal protégés, et ce sans gants, ni masque, ni blouse de protection. Ironie du sort, c’est au lendemain de l’annonce de ce cas que le comité d’experts diligenté par l’OMS sur l’amélioration des procédures de biosécurité dans les laboratoires stockant des souches du Sras entre en fonction.
En avril 2004, la Chine fait part d’un cas de Sras détecté sur une infirmière ayant soigné une chercheuse de l’Institut national chinois de Virologie. Tout en étant malade, la scientifique avait pris le train à deux reprises pour se rendre de Pékin à la province d’Anhui, où sa mère, médecin, l’avait aussi soignée. La mère, contaminée, mourut. Quant à l’infirmière, elle infecta cinq cas de troisième génération, sans qu’aucun ne soit mortel.
Des enquêtes ultérieures détecteront trois cas supplémentaires d’infection, sans lien entre eux, et survenus en laboratoire sur d’autres membres de l’Institut de virologie. Au moins deux patients primaires n’ont jamais travaillé en contact direct avec des souches vivantes de Sras.
Plusieurs failles de biosécurité sont découvertes à l’Institut, et la cause spécifique de l’épidémie est retracée dans une préparation de Sras mal inactivée et utilisée dans des zones génériques (ie. non biosécurisées) du laboratoire, dont une où les cas primaires travaillaient. L’inactivation de la préparation n’avait pas été confirmée par des tests adéquats, contrairement aux procédures obligatoires.
2007 | Fièvre aphteuse en Grande-Bretagne
La fièvre aphteuse infecte les animaux à sabot fendu, comme les porcs, les moutons et les bovins. Elle a été éradiquée en Amérique du Nord et dans la grande majorité des pays européens. Elle est extrêmement contagieuse, et peut se propager par contact direct via les bottes des ouvriers agricoles et par aérosols naturels susceptibles de parcourir jusqu’à 250 km. Les foyers de fièvre aphteuse survenant dans des zones où la maladie a préalablement été éradiquée sont des désastres économiques, vu que les exportations de viande doivent être arrêtées et les animaux abattus en masse.
En 2001, une flambée de fièvre aphteuse au Royaume-Uni s’était soldée par l’euthanasie de 10 millions d’animaux et une perte économique estimée à 16 milliards de dollars.
En 2007, la fièvre aphteuse réapparaît en Grande-Bretagne, à 4 kilomètres d’un laboratoire P4 –soit le niveau de biosécurité le plus élevé– situé à Pirbright. En 1967, la souche avait causé une épidémie au Royaume-Uni, mais n’avait plus circulé depuis parmi les troupeaux. Par contre, on la retrouvait dans des vaccins fabriqués par l’établissement de Pirbright.
Selon les conclusions des enquêtes, des véhicules de chantier avaient transporté de la boue contaminée par le pathogène, à cause d’un système d’évacuation des eaux défectueux, de Pirbright à une première exploitation agricole. L’épidémie toucha 278 animaux, et 1.578 durent être abattus. Elle influa aussi sur la production et les exportations agricoles anglaises, pour un coût estimé à 200 millions de livres sterling.
Aux Etats-Unis, des lois fédérales interdisent le stockage de souches de fièvre aphteuse sur le continent américain. Le seul laboratoire qui en contient est celui du département de l’Agriculture situé sur l’île de Plum, au large de Long Island, dans l’Etat de New York. La construction de son remplaçant, la National Bio and Agro-Defense Facility, vient pourtant d’être lancée à Manhattan, dans le Kansas, sous l’égide du département de la Sécurité Intérieure. Le déménagement des recherches sur la fièvre aphteuse dans le cœur agricole des Etats-Unis ne s’est pas fait sans opposition, notamment de la part du Government Accountability Office, mais le département de la Sécurité Intérieure n’a pas flanché. Le problème, c’est qu’en construisant de nouveaux établissements high-tech visant à combattre le bioterrorisme agricole, le département ne fait qu’aggraver le risque pesant sur l’agriculture américaine, via une fuite involontaire.
* * *
Ces histoires de fuites de pathogènes ont plusieurs trames communes. Des failles techniques non-détectées, comme avec les cas britanniques de variole et de fièvre aphteuse. Des préparations mal inactivées de pathogènes dangereux, manipulées dans des zones où la biosécurité n’est pas optimale, dans les fuites du Sras et de l’EEV. La première infection, ou patient-zéro, qui survient chez une personne qui ne travaille pas directement en contact avec le pathogène qui l’infecte, comme dans les cas de Sras ou de variole. Dans ces cas-là, il y a aussi le problème d’un personnel mal formé et de procédures de biosécurité mal appliquées, qui contredisent les efforts d’agences nationales et internationales.
Difficile d’être rassuré par le fait que, malgré des avancées techniques dans le confinement des laboratoires, et une demande politique accrue pour des procédures de biosécurité rigoureuses lors de manipulations de dangereux pathogènes, des fuites potentiellement à très haut risque surviennent quasiment tous les jours : en 2010, 244 rejets non-intentionnels d’« agents sélectifs » susceptibles d’entrer dans la composition d’armes biologiques ont ainsi été rapportés.
Quand on regarde le problème d’un œil pragmatique, la question n’est pas de savoir si ce genre de fuite provoquera un jour une épidémie majeure dans la population, mais plutôt de connaître le pathogène qui en sera responsable et de réfléchir à des moyens de contenir la fuite, si jamais elle peut l’être.
Des expériences qui augmentent la virulence et la contagiosité de pathogènes dangereux ont été financées et réalisées, notamment avec le virus de la grippe aviaire H5N1. L’opportunité de réaliser de telles expériences –en particulier dans des laboratoires universitaires, situés dans des zones urbaines densément peuplées, et où un personnel potentiellement exposé est en contact quotidien avec une multitude de citoyens ignorant qu’ils peuvent être contaminés– est clairement problématique.
Si de telles manipulations doivent être autorisées, la prudence voudrait qu’on les effectue dans des laboratoires isolés, avec un personnel séquestré du reste de la population et devant obligatoirement en passer par une période de quarantaine avant de retourner à la vie civile. Car ce que l’histoire nous enseigne, ce n’est pas un si, mais un quand l’ignorance de telles mesures nous en coûtera en santé et en vies. Et des vies sans doute très nombreuses.
Traduit par Peggy Sastre














