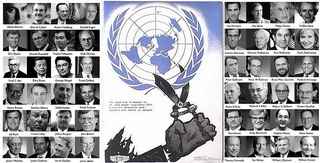Si l’on ne sait toujours pas quel type d’accord de paix en Ukraine l’administration de Donald Trump entend conclure avec la Russie, les Européens ne doivent pas douter de ce que l’on attendra d’eux par la suite. Comme l’a récemment prévenu le conseiller à la sécurité nationale Michael Waltz, notre « principe sous-jacent » est que les Européens « doivent s’approprier ce conflit à l’avenir. Le président Trump va y mettre fin, et ensuite, en termes de garanties de sécurité, ce sera aux Européens de s’en charger ».
La réaction des Européens dans les semaines à venir aura une grande influence non seulement sur le sort de l’Ukraine, mais aussi sur l’avenir du partenariat transatlantique qui a été si vital pour leur sécurité pendant près de huit décennies. Il est clair qu’ils doivent faire un pas en avant et assumer davantage de responsabilités pour leur propre défense et le maintien de la paix sur le continent. S’ils ne le font pas, le partenariat s’effilochera irrémédiablement et leurs aspirations à être pris au sérieux dans l’ordre mondial multipolaire émergent se révéleront vides de sens.
Dans le même temps, l’administration Trump ne peut pas se permettre de voir les Européens échouer. Elle doit veiller à ce que tout cessez-le-feu en Ukraine reste intact et que la Russie ne l’utilise pas simplement pour faire une pause avant de reprendre sa guerre d’agression barbare. Pour ce faire, les États-Unis doivent continuer à fournir une assistance militaire à l’Ukraine et indiquer qu’ils soutiendront les efforts européens visant à garantir la paix. Ce n’est qu’avec de telles assurances crédibles que le président russe Vladimir Poutine acceptera et respectera un cessez-le-feu.
Pour paraphraser le vieux dicton sur l’objectif fondateur de l’Organisation du traité nord-américain (OTAN), l’objectif pour l’Ukraine devrait être de « maintenir les Russes à l’extérieur, les Européens à l’intérieur et les Américains en attente ». Comment y parvenir ?
Tout d’abord, les Européens doivent fournir à l’administration Trump un plan clair et réaliste sur la manière dont ils peuvent, ensemble, soutenir les forces de défense nationale de l’Ukraine de manière équitable dans un avenir prévisible. Nous avons calculé comment l’Ukraine peut répondre à l’essentiel de ses besoins en matière de défense avec les effectifs dont elle dispose pour environ 20 à 40 milliards de dollars par an, ce qui n’est pas sans rappeler ce qu’Israël ou la Corée du Sud dépensent pour leur sécurité. Cela nécessite, entre autres, la poursuite des livraisons d’armes, du soutien en matière de renseignement et de la formation par l’Occident.
Deuxièmement, les Européens doivent contribuer à soutenir la sécurité de l’Ukraine avec leurs propres forces. Compte tenu des penchants de Poutine, un soutien pro forma à une force de surveillance internationale, que ce soit sous les auspices des Nations unies ou de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, composée principalement de troupes d’autres pays, n’est pas suffisant. Les Européens doivent « mettre la main à la pâte », ce que seule la présence d’un déploiement militaire important d’au moins vingt mille hommes sur le sol ukrainien peut faire.
Mais quelle organisation ou coalition pourrait être le fer de lance de cett organisation ? L’une des options serait d’invoquer la formule « Berlin-plus », conçue pour permettre à l’Union européenne (UE) de puiser dans les ressources de l’OTAN pour soutenir ses propres missions à l’étranger dans le cadre de la politique de sécurité et de défense commune. En suivant cette voie, l’UE appuierait sa proposition de faire de l’Ukraine un membre de l’Union et signalerait également son intention d’être prise au sérieux en tant qu’acteur géopolitique. Cette approche a déjà été utilisée à deux reprises au moins pour des opérations de maintien de la paix dans les Balkans. Une telle approche pourrait également permettre au Royaume-Uni, qui ne fait plus partie de l’UE mais qui est l’une des trois premières puissances militaires européennes, de participer et d’apporter sa contribution.
Une « coalition de volontaires » européenne
Si cette option est trop difficile à mettre en œuvre parce qu’elle nécessite le soutien unanime de tous les membres de l’UE - ce qui n’est pas acquis -, les Européens peuvent alors organiser une coalition de volontaires, ce qui constitue la meilleure solution suivante. Il existe un précédent pour une telle coalition : la Force expéditionnaire conjointe (JEF) multinationale dirigée par le Royaume-Uni, établie en 2018, s’appuie sur les ressources de l’OTAN pour répondre aux menaces en Europe du Nord et dans la région de la Baltique. Cependant, au lieu de la force de réaction rapide relativement petite de la JEF, composée d’environ dix mille soldats, une coalition dirigée par l’UE nécessiterait quelque chose de plus robuste, impliquant des contributions de la Bulgarie, de la France, de l’Allemagne, de la Pologne, de la Roumanie et du Royaume-Uni.
Sur le plan militaire, l’idée clé est la suivante : quelles que soient les troupes étrangères présentes en Ukraine dans le cadre d’un futur armistice, elles doivent être capables de se battre sur place pour se défendre contre une éventuelle attaque russe jusqu’à l’arrivée de renforts. Si l’Ukraine fait sa part et met en place une force d’autodéfense viable, la capacité européenne servira principalement de renfort et ne risquera pas d’être débordée dans les premiers jours d’une guerre hypothétique. Elle devrait avoir le temps de consolider ses éléments disparates en Ukraine et d’organiser une défense sérieuse en collaboration avec Kiev. Cela ne nécessiterait pas les deux cent mille soldats européens proposés par le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy, mais peut-être vingt mille, compte tenu de l’organisation et de la structure des armées modernes. Par exemple, les équipes de combat de brigade modernes - les principales unités de combat des armées occidentales aujourd’hui - se composent généralement de 3 500 soldats, auxquels s’ajoutent deux à trois fois plus d’individus en uniforme en soutien et plusieurs milliers de personnes supplémentaires pour fournir des capacités aériennes.
Garanties de sécurité américaines
Troisièmement, alors que l’Europe montre qu’elle est prête à s’engager, les États-Unis ne peuvent pas rester en retrait. L’administration Trump doit faire comprendre aux Européens qu’elle soutient leur engagement en faveur de la défense de l’Ukraine - matériellement et politiquement - et fournir ainsi l’autre élément clé d’une stratégie de dissuasion sérieuse contre la Russie. Les Européens ne peuvent tout simplement pas le faire seuls et ne devraient pas avoir à essayer. Le futur dispositif militaire américain en Europe doit se déplacer un peu plus à l’est qu’il ne l’était avant 2022, avec des forces d’intervention en Pologne et peut-être aussi dans les États baltes. Encore une fois, le chiffre approximatif est peut-être de dix mille soldats américains supplémentaires en Pologne ou dans les pays de l’Est, en plus des cinq mille soldats déployés dans cette région en 2021. Ce type de chiffres témoigne du sérieux de la puissance de combat et du soutien logistique. En outre, les États-Unis ne devraient pas exclure a priori le déploiement de forces à l’intérieur de l’Ukraine, ce que le vice-président américain JD Vance a récemment indiqué comme n’étant pas exclu.
La démarche de M. Waltz auprès des alliés de l’OTAN est juste, jusqu’à un certain point. Les Européens doivent en faire plus, mais les deux guerres mondiales immensément coûteuses du siècle dernier devraient rappeler à Waltz que ce n’est pas le moment pour les États-Unis d’en risquer une troisième en se désengageant précipitamment de l’Ukraine une fois que les armes se seront tues.