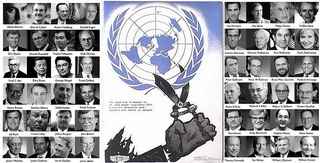Cinq priorités pour faire progresser la mission spatiale de l’OTAN
Les progrès de l’OTAN dans le domaine de la « dernière frontière » sont notables, mais insuffisants compte tenu de la dégradation de l’environnement de sécurité, de la vitesse vertigineuse à laquelle évolue l’industrie spatiale commerciale et du grand intérêt que portent les alliés à l’espace. Nous pensons que les prochains mois offriront une occasion cruciale de faire progresser la mission spatiale de l’OTAN et nous proposons cinq recommandations.
1. Actualiser le plan d’action de l’OTAN en matière de dissuasion et de défense spatiales
L’OTAN devait actualiser sa politique spatiale pour 2019 afin de mieux refléter l’environnement de menace actuel et de compléter la prochaine doctrine spatiale de l’OTAN. L’environnement de menace reste contesté en Europe, sur Terre et dans l’espace, car on craint que la Russie ne mette des armes nucléaires en orbite ou ne se livre à d’autres activités malveillantes. En outre, les activités spatiales de la Chine, notamment le déploiement de satellites à double usage ayant des applications à la fois militaires et civiles, restent préoccupantes.
Les alliés de l’OTAN devraient également redoubler d’efforts pour élaborer des scénarios de riposte interne à divers scénarios spatiaux relevant de l’article 5 et les diffuser au sein de l’alliance par le biais d’études, de wargames et de réunions d’information. Ces manuels aideraient à cartographier les autorités nationales et internationales, les capacités, les options de réponse, les lignes rouges et les différences de priorités entre les alliés. Ils devraient explorer plusieurs éventualités spatiales particulièrement épineuses : la transition de l’OTAN du temps de paix au temps de conflit en cas de crise spatiale ; le rôle de l’OTAN dans la défense des biens spatiaux commerciaux alliés ciblés par des adversaires ; le rôle de l’OTAN dans la protection individuelle des satellites et des stations terrestres alliés ; la dissuasion et l’escalade inter-domaines ; et le ciblage potentiel des capacités adverses dans des pays tiers en réponse à une attaque.
L’OTAN pourrait en outre tirer profit de l’extension de ces efforts de coordination à certains États membres et non membres et de la socialisation de sa réflexion lorsqu’elle se prépare à des situations d’urgence spécifiques. Par exemple, les exercices de l’OTAN pourraient à la fois tirer des enseignements de l’opération de la force multinationale Olympic Defender et la renforcer. En outre, les partenaires de l’OTAN qui disposent d’importantes capacités spatiales et de synergies, comme le Japon, pourraient être invités à participer aux exercices et aux discussions, le cas échéant. Ces manuels peuvent aider les alliés à mieux connaître leur perception mutuelle des menaces et à développer un « QI spatial » sur la manière d’anticiper et de coordonner les actions, tout en maintenant l’ambiguïté stratégique qui sous-tend l’article 5. S’il est compréhensible que des appels soient lancés en faveur de l’établissement de « lignes rouges » spécifiques contre les actions de l’adversaire dans l’espace, nous maintenons qu’une ambiguïté calculée peut soutenir la dissuasion et préserver la souveraineté des alliés en matière de prise de décision politique.
2. Mettre en œuvre la stratégie de l’OTAN pour l’espace commercial
Le secrétaire général adjoint de l’OTAN pour les opérations, M. Thomas Goffus, a fait remarquer qu’en raison de l’explosion des capacités spatiales commerciales, l’espace n’est plus « trop cher, trop exquis et trop classifié ». L’OTAN doit comprendre comment utiliser ces ressources pour renforcer son avantage militaire. Les capacités spatiales commerciales peuvent permettre aux États de répondre aux exigences de leurs missions de manière plus efficace, à moindre coût et avec potentiellement plus de possibilités de mise à niveau. L’OTAN reconnaît cette dynamique. Bientôt, l’Alliance prévoit de rendre publique sa première stratégie en matière d’espace commercial.
Bien qu’il s’agisse d’une étape importante dans l’affirmation du rôle de l’espace commercial, le succès du plan dépendra de sa stratégie, et en particulier du modèle que l’OTAN développera pour son engagement avec l’industrie. Les recherches antérieures de la RAND mettent en évidence plusieurs recommandations. Premièrement, l’OTAN devrait développer des partenariats solides et des canaux de communication avec les acteurs de l’industrie spatiale. En s’appuyant sur l’exemple positif de SPACENET, une plateforme de l’OTAN pour engager les fournisseurs de l’espace, l’OTAN devrait continuer à apporter de la transparence à ses communications et se concentrer sur l’inclusion des petites et moyennes entreprises et des sociétés non traditionnelles, qui représentent l’épine dorsale des industries de défense alliées.
Deuxièmement, l’OTAN devrait désigner, autoriser et doter en ressources une institution chargée de superviser l’engagement avec les fournisseurs commerciaux de l’espace. Actuellement, les responsabilités sont réparties entre le Centre d’opérations spatiales de l’OTAN, le Centre d’excellence pour l’espace et d’autres organismes, ce qui pourrait conduire à une coordination insuffisante.
Troisièmement, l’engagement avec l’industrie doit être orienté vers l’action afin d’instaurer la confiance et l’appropriation. Les premières conversations devraient porter sur les moyens d’alléger les charges réglementaires qui ralentissent les délais d’acquisition. Les dirigeants de l’OTAN et de l’industrie devraient partager des informations sur les niveaux de risque acceptables dans les opérations spatiales et sur la manière de renforcer la résilience pour garantir l’accès. L’utilisation de capacités spatiales commerciales est autant un changement culturel que technique. Comme l’a récemment déclaré le général de corps d’armée Michael Guetlein : "Par le passé, nous ne pensions pas pouvoir compter sur nos partenaires commerciaux et internationaux en temps de crise. Cela a complètement changé. Le plan de mise en œuvre de la stratégie de l’OTAN pour l’espace commercial offre l’occasion d’approfondir cet engagement et de suivre l’évolution d’un secteur qui change radicalement tous les six mois.
3. Financer l’entreprise spatiale alliée
Les alliés de l’OTAN disposent de budgets très restreints consacrés à l’espace au sein de leurs propres services militaires, en dépit des augmentations récentes et attendues des dépenses globales de défense. En outre, seulement 0,3 % environ des dépenses de défense des alliés sont consacrées spécifiquement à l’OTAN par le biais d’un financement commun pour des éléments d’intérêt partagé tels que les coûts opérationnels, les capacités et les installations conjointes. Le financement commun reste difficile à débourser et exige souvent qu’un pays « prenne en charge » les coûts de démarrage d’un programme approuvé conjointement. Nous suggérons plutôt le modèle de financement par projet à l’appui des efforts de coopération multinationale en matière de capacités, comme celui mis en place dans le cadre du programme APSS (Alliance Persistent Surveillance from Space) pour intégrer les défenses alliées.
Les efforts de l’UE pourraient également constituer une source de financement supplémentaire. Les membres de l’UE ont finalisé l’accord pour le prêt SAFE de 150 milliards d’euros dans le cadre du paquet plus large de la Commission européenne (ReArm Europe/Readiness 2030 Plan) pour soutenir le réarmement de l’UE. Le financement du programme de prêt pourrait être utilisé pour développer et intégrer les capacités spatiales européennes par les États de l’OTAN, y compris ceux qui sont membres de l’Union européenne et ceux, comme la Norvège, le Canada et les États-Unis, qui ne le sont pas mais qui peuvent participer au programme SAFE. En outre, l’OTAN pourrait envisager d’étendre sa coopération avec l’Agence spatiale européenne, qui se concentre de plus en plus sur les capacités à double usage et redéfinit son rôle en matière de défense.
4. Développer des capacités et des effets spatiaux interopérables
Pour assurer une dissuasion crédible, il faut mettre en place des capacités appropriées. Pour la première fois, le cycle du processus d’établissement des plans de défense de l’OTAN (NDPP) de cette année inclura les besoins spatiaux des armées alliées. Il est à noter que l’OTAN est également en train de modifier ses objectifs en matière de capacités spatiales pour adopter une approche basée sur les effets pour chaque allié, en se concentrant sur la quantification de la « puissance de feu » disponible pour les alliés. L’OTAN devrait s’appuyer sur ces progrès en aidant les alliés à identifier les domaines d’intérêt commun pour le développement coordonné des capacités spatiales.
Deuxièmement, les Alliés devraient envisager de généraliser le format de coopération multinationale en matière de capacités, qui permet l’achat et l’acquisition en commun de capacités dans des domaines où les besoins sont immédiats. De plus en plus, l’OTAN utilise un modèle de coalitions basées sur des projets pour lancer des actions dans des domaines d’intérêt immédiat - NORTHLINK, STARLIFT, « Project Asgard », Sky Fortress en sont des exemples positifs, l’APSS étant sans doute celui qui a le mieux réussi.
Lancé par le Luxembourg avec 17,7 millions de dollars pour lancer l’effort d’intégration qui serait disponible pour les 32 alliés, le programme a maintenant attiré plus d’un milliard de dollars de contributions alliées sous forme de données, de PED et d’argent au cours des cinq prochaines années. Ce modèle peut être généralisé pour des facilitateurs spatiaux particulièrement critiques tels que les communications par satellite, le renseignement, la surveillance et la reconnaissance, et le commandement et le contrôle, mais aussi pour des domaines de capacités émergents tels que la logistique spatiale ou la fabrication et l’assemblage dans l’espace.
Pour maximiser le retour sur investissement, les alliés de l’OTAN devraient également identifier les domaines dans lesquels ils peuvent rechercher des capacités conjointes et complémentaires plutôt que des capacités souveraines et redondantes. Par exemple, les constellations d’imagerie à haute résolution relèvent facilement de la première catégorie, alors que les satellites utilisés pour le commandement et le contrôle nucléaires seront certainement détenus et exploités par des États individuels. Toutes les capacités spatiales ne peuvent cependant pas être catégorisées aussi facilement, et il existe donc une longue liste de biens pour lesquels une discussion est justifiée. De même, alors que les alliés européens s’inquiètent à juste titre de leur dépendance excessive à l’égard des défenses et des garanties de sécurité américaines, un effort actif pour compléter les constellations spatiales américaines plutôt que de les remplacer pourrait rappeler aux décideurs américains les avantages d’une coopération entre alliés dans ce domaine.
5. Réaffirmer le rôle de l’OTAN en tant que courtier de l’espace
La principale proposition de valeur de l’OTAN est de servir d’espace de rassemblement pour les alliés afin de discuter, débattre, coordonner et aligner les activités de défense. Les dirigeants de l’OTAN promeuvent souvent des normes mondiales favorables à la défense collective et à la stabilité stratégique, telles que des comportements responsables dans l’espace. Ils peuvent aider les décideurs nationaux à créer des normes techniques et opérationnelles pour le développement et l’utilisation de moyens spatiaux militaires, afin que les alliés puissent investir dans des systèmes militaires locaux tout en maintenant l’interopérabilité. L’OTAN peut également servir de catalyseur pour rationaliser le partage des données du renseignement, mener des exercices conjoints et faciliter le développement des capacités.
Nous soutenons que l’OTAN devrait se concentrer sur ce qu’elle fait généralement le mieux et l’appliquer à l’espace en servant d’intermédiaire pour les 32 membres de l’alliance dans de multiples dimensions. L’OTAN devrait continuer à mettre sa plate-forme à contribution dans des domaines essentiels, tels que l’établissement de normes spatiales, le développement du « QI spatial » parmi les pays alliés et leur personnel, l’amélioration de la coordination et de l’état de préparation, ainsi que l’organisation de wargames et d’exercices dans le domaine de l’espace.
À mesure que le rôle de l’espace s’accroît dans l’architecture de l’OTAN, il est également possible que l’alliance joue un rôle plus tourné vers l’avenir. Toutefois, cette voie alternative est nettement plus complexe. Par exemple, les propositions d’architectures spatiales « opérées par l’OTAN » sont limitées par les fonds extrêmement faibles disponibles pour la mise en commun des ressources et par les défis politiques importants que pose le maintien de tels efforts multinationaux.
Les efforts spatiaux de l’OTAN ont considérablement évolué depuis le lancement de la politique spatiale de l’OTAN il y a cinq ans. Nous pensons qu’en poursuivant ces cinq priorités, l’OTAN peut continuer à progresser dans ce domaine essentiel.