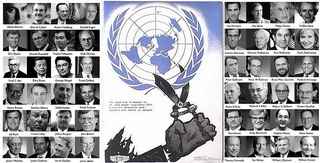L’année 2024 restera gravée dans l’histoire économique d’Israël comme l’une de ses pires années. La croissance du PIB par habitant a été négative pour la seconde année consécutive, les principaux moteurs de croissance israélienne (exportations et investissements) se sont effondrés, les prix au détail montent en flèche et le déficit public atteint des proportions démesurées. Certes, Israël connait la guerre la plus longue de son histoire ; une guerre multi-fronts et d’une rare puissance, conduisant à des dépenses de défense jamais égalées. Forcément, une guerre couteuse affecte l’économie dans sa globalité ; les répercussions économiques ont aussi été aggravées par les multiples défaillances du gouvernement israélien, la poursuite de sa politique ultralibérale n’étant pas toujours compatible avec une économie en guerre.
Recul de l’activité
Les répercussions du conflit se sont fait ressentir dès le dernier trimestre 2023 ; le PIB a chuté de 21,4 % par rapport au trimestre précédent, et le rebond du premier trimestre 2024 (+15,6 %) ne comblera que partiellement le recul de l’activité (1). En raison de la situation sécuritaire, les perturbations de l’offre et la diminution marquée de la population active civile, ainsi que la dégradation du climat économique, pénaliseront d’abord la consommation privée et les investissements, puis les échanges extérieurs, le commerce et le tourisme. Le quatrième trimestre 2023 sera une catastrophe absolue pour l’économie du pays : l’augmentation considérable des dépenses militaires a fait bondir la dépense publique de 84 % en rythme annuel, alors que la consommation des ménages chutait de 26,3 %, les investissements faisaient un bond en arrière de 69,6 % et les exportations de biens et services reculaient de 21,6 %.
L’arrêt de l’économie israélienne le 7 octobre 2023 a été déclenché par la fermeture du système scolaire durant plusieurs semaines ainsi que par la fermeture de commerces, industries et services ; la mobilisation par Tsahal de 280 000 réservistes (7 % de la population active) a pesé sur l’ensemble de l’économie, secteur des hautes technologies compris. Au plus fort de la guerre, ce sont près de 800 000 Israéliens qui sont sortis du marché du travail, soit 20 % de la population active du pays : réservistes de l’armée, familles déplacées de leur domicile, victimes de guerre, salariés en congé sans solde, parents d’enfants déscolarisés, etc.
De plus, la suspension des permis de travail aux Palestiniens et le départ de nombreux travailleurs étrangers pèsent lourdement sur l’économie. En 2022, soit avant la guerre à Gaza, l’économie israélienne employait 250 000 étrangers : 120 000 ouvriers palestiniens (de Cisjordanie et Gaza) et 130 000 étrangers de pays lointains (Thaïlande, Philippines, Inde, Chine, etc.). Ces travailleurs non-israéliens représentaient 6 % de la population active du pays, soit une force de travail importante (2). Leur absence est fortement ressentie dans certaines activités qui sont dépendantes de cette main-d’œuvre travailleuse et bon marché, comme le BTP et l’agriculture. En conséquence, les investissements dans la construction d’habitations ont chuté de 52 % au quatrième trimestre 2023 (par rapport au trimestre précédent), alors que les récoltes agricoles furent quasiment interrompues.
En fait, 2023 avait déjà démarré au ralenti pour l’économie israélienne en raison d’une réforme judiciaire lancée par la coalition gouvernementale dirigée par Benyamin Netanyahou (depuis décembre 2022) et qui ne parvenait pas à convaincre de son opportunité de nombreux Israéliens et observateurs étrangers. La guerre déclenchée le 7 octobre n’aura fait qu’amplifier le ralentissement économique qui avait commencé à se faire ressentir durant les mois précédents ; sur toute l’année 2023, la croissance du PIB s’est établie à 1,8 %, soit une contraction du PIB par habitant de -0,1 %.
Évolution en dents de scie
Sur l’ensemble de 2024, le PIB d’Israël a augmenté de 1 %, soit un recul de 0,3 % du PIB par habitant, compte tenu de la croissance démographique de l’an passé (+1,3 %). L’activité économique ne s’est pas déroulée de façon uniforme tout au long de l’année ; elle a connu une évolution trimestrielle en dents de scie, avec des hauts et des bas au gré des conflits, risques et incertitudes. Après la forte reprise du premier trimestre 2024 (+15,6 %), le taux de croissance du PIB a chuté au second trimestre (-0,8 %) pour rebondir au troisième trimestre (+5,3 %) et connaitre une croissance modérée au dernier trimestre 2024 (+2,5 %) en glissement annuel (3).
La croissance 2024 a été soutenue par la forte augmentation des dépenses publiques qui ont bondi de +13,7 % par rapport à 2023 : l’État a davantage accru ses dépenses de défense (+43,3 %) que ses dépenses civiles (+4,2 %). Les moteurs traditionnels de l’économie israélienne se sont carrément éteints en 2024 : les exportations de biens et services ont reculé de 5,6 % par rapport à 2023, notamment les exportations de diamants (-20,3 %) et de hautes technologies (-36,8 %). Quant aux investissements en capital fixe, ils ont baissé de 5,9 % en 2024, surtout dans la construction (-17,5 %) et l’industrie (-1,6 %).
Si le pire a pu être évité en 2024, c’est aussi grâce à la consommation privée qui a tenu bon : si la guerre a pesé sur le moral des consommateurs, ils se sont vite ressaisis. Après une chute au premier trimestre (-3,8 % par tête en rythme annuel), la consommation des ménages est repartie lentement malgré la confiance en berne d’une majorité d’Israéliens. Sur toute l’année 2024, les ménages ont relevé leur consommation de 2,6 % par tête, davantage en biens durables (+7,8 %) qu’en dépenses courantes (+0,7 %).
Libéralisme de guerre
La stratégie adoptée par le gouvernement israélien pour faire face aux répercussions économiques de la guerre est restée fidèle à son idéologie libérale et conservatrice. Le ministre des Finances Bezalel Smotrich, qui gère les caisses de l’État depuis deux ans et demi, applique un programme économique néolibéral, tout en laissant une large place aux principes religieux de l’orthodoxie juive. En définitive, la guerre à Gaza et au Liban n’a pas ralenti le glissement vers la droite de l’économie israélienne ; pour financer des dépenses militaires, le gouvernement israélien est fidèle à son idéologie ultralibérale de dépenser le moins d’argent public possible. Alors que dès octobre 2023, les recettes fiscales ont reculé pour cause de récession, le grand argentier est resté réticent à des hausses d’impôt sur le revenu, préférant réduire les dépenses sociales : l’éducation, la santé et les transports publics n’ont pas échappé à de sévères coupes budgétaires.
Naturellement, la guerre a engendré de lourds couts pour l’économie : après 18 mois de combats, et sous l’hypothèse d’une fin de guerre au premier semestre 2025, la Banque d’Israël a estimé le cout global de la guerre à 250 milliards de shekels ou 65 milliards d’euros, l’équivalent de 13 % du PIB annuel israélien, un cout qui se partage à parts quasi-égales entre budget militaire et dépenses civiles d’indemnisations. Face à des recettes fiscales insuffisantes, les dépenses budgétaires sont restées soutenues depuis 2023 et pas seulement à cause de la guerre : la stabilité gouvernementale est garantie par d’importantes subventions aux partis ultraorthodoxes et sionistes religieux, ainsi que par de fortes dépenses de fonctionnement qui entretiennent un gouvernement pléthorique (33 ministres et 5 vice-ministres).
Avec l’évolution des conflits tout au long de 2024 et l’augmentation rapide des dépenses militaires, Bezalel Smotrich s’est résolu à relever la pression fiscale mais en prenant des mesures de nature libérale, c’est-à-dire en faveur des plus riches et au détriment des plus modestes. En 2025, il a choisi de ne pas relever l’impôt sur le revenu du travail, alors que les taux d’imposition en Israël sont parmi les plus bas des pays de l’OCDE (4). En revanche, les impôts indirects et tarifs publics ont été fortement alourdis sur le consommateur : le taux standard de la TVA a été relevé de 17 à 18 %, la taxe d’habitation s’est accrue de 5,3 %, le ticket de transports en commun a connu un bond de 33 %, les tarifs de l’électricité ont augmenté de 3,8 %.
Les retombées d’une politique budgétaire qui est devenue expansionniste dans le courant 2024 ne se sont pas fait attendre : les comptes publics ont basculé d’un excédent budgétaire de 0,4 % du PIB en 2022, à un déficit de 4,1 % du PIB en 2023 et 6,9 % en 2024. Quant à la dette extérieure, elle passera de 60 % du PIB en 2022 à 62 % en 2023 et 69 % en 2024. Les risques de guerre et les incertitudes sur les capacités de l’économie à se redresser ont conduit chacune des trois principales agences de notation à revoir à la baisse l’évaluation de la dette publique tout au long de 2024 : Moody’s a abaissé sa note de crédit d’Israël à deux reprises (février et septembre) comme Standard & Poor’s (avril et octobre) puis Fitch (aout). Sous l’effet d’un début de désinflation et de la stabilité de la monnaie, la Banque d’Israël avait abaissé son taux d’intérêt directeur de 4,75 % à 4,5 % en janvier 2024. Les contraintes de l’offre ont ensuite contribué à l’accélération de l’inflation qui est passée d’un rythme annuel de 2,5 % à 3,5 % entre février et novembre 2024 puis à 3,8 % en janvier 2025, obligeant la Banque centrale à laisser son taux d’intérêt inchangé à 4,5 % depuis un an et demi (5).
Paradoxalement, la situation de guerre n’a pas interrompu, ni même ralenti, le processus de privatisation des services publics lancé en Israël il y a quelques années. En mai 2024, le gouvernement israélien a finalisé la privatisation de la Poste en la cédant au groupe Milgam, propriété de la famille Weil qui est à la tête d’un important empire financier dans le pays. Au milieu de l’été 2024, ce fut au tour du marché de l’électricité de s’ouvrir à la concurrence, faisant perdre à la Compagnie nationale d’électricité le monopole de la distribution. Début 2025, la privatisation se poursuit avec le dernier port public israélien d’Ashdod qui sera cédé à un investisseur étranger.
Guerre des pauvres
Le conflit ouvert le 7 octobre 2023 a conduit à un appauvrissement croissant de nombreux groupes de la population israélienne. En fait, les zones touchées directement par la guerre (Nord et Sud d’Israël) sont des régions qui étaient déjà les plus pauvres du pays avant la guerre. Le rapport 2023 sur la pauvreté et les inégalités que publie l’Institut d’assurance nationale (6) indique que 1,98 million d’Israéliens vivent sous le seuil de pauvreté, soit 20,7 % de la population ; ce taux monte à 24,5 % dans la région Sud et 21,7 % dans la région Nord, contre 11,6 % d’Israéliens pauvres dans la région Centre du pays.
Les chiffres de 2023 ne prennent pas en compte les retombées de la guerre sur le portefeuille des Israéliens en 2024 ; la pauvreté fera un bond supplémentaire en raison de la guerre qui a affaibli le pouvoir d’achat des Israéliens déjà pauvres et des classes moyennes qui se sont appauvries. Beaucoup d’Israéliens ont vu leurs revenus chuter fortement durant la guerre, notamment les 150 000 familles déplacées du Sud et du Nord, qui ont cessé leur travail durant plusieurs mois. Des secteurs d’activité entiers tournent encore au ralenti (comme agriculture et tourisme) ; leur redémarrage prendra du temps, laissant dans le désarroi les familles qui en vivent. Mobilisés par Tsahal, des travailleurs indépendants ont dû fermer leurs commerces, perdant leurs investissements et sources de revenu. Les salariés ont vu leurs salaires gelés alors que les prix au détail continuent de s’envoler, entrainant une perte sensible de leur pouvoir d’achat.
Certes, l’État a versé des dédommagements aux déplacés et victimes de la guerre, mais les aides sont lentes et partielles ; sans compter que les critères d’attribution sont parfois sévères et laissent sur le carreau de nombreux professionnels. La pauvreté n’est pas un phénomène nouveau en Israël ; en revanche, elle s’est aggravée depuis le début des années 2000 avec le vent de libéralisme qui a soufflé sur le pays et lorsque le filet de protection sociale s’est aminci. Quant à la politique fiscale mise en place durant cette guerre, elle continue de favoriser les plus riches et de couper dans les services publics aux plus pauvres.
L’augmentation significative du volume de migration négative est une des autres retombées significatives de la guerre actuelle sur l’unité de la société israélienne. En 2024, 82 700 Israéliens ont quitté le pays, contre seulement 23 800 citoyens qui sont revenus au pays. Israël a donc perdu 58 900 habitants uniquement par le biais des migrations des Israéliens vers des pays plus accueillants (7). Les émigrants actuels se caractérisent par un niveau socio-économique et éducatif plus élevé que la moyenne nationale. Or en Israël, la démographie est un fort moteur de la croissance économique, qui repose sur la matière grise de sa population. Les conséquences négatives de l’émigration sont donc très vastes ; la fuite des cerveaux est préjudiciable à l’économie et elle est un facteur d’appauvrissement sociétal.
Rails de la croissance
Les conflits en cours au Proche-Orient continueront d’exercer une influence majeure sur les perspectives de l’économie israélienne. Selon les récentes prévisions de l’OCDE (8), la croissance du PIB israélien s’établira à un petit 2,4 % en 2025 avant de repartir à 4,6 % en 2026. Une normalisation du climat économique devrait favoriser un redressement des exportations, notamment dans les services de hautes technologies, de la consommation privée et des investissements, alors que la consommation publique va se ralentir.
La reprise de l’activité économique, amorcée modérément au second semestre de 2024, ne garantit pas le retour d’une croissance forte et durable en 2025. Des réformes structurelles sont nécessaires pour remettre l’économie sur les rails de la croissance et améliorer durablement les niveaux de vie. Il s’agirait de rehausser la productivité en améliorant les compétences des Juifs ultraorthodoxes et des Arabes israéliens pour mieux les intégrer sur le marché du travail, de réaliser des investissements massifs en infrastructures, de réduire les obstacles à la concurrence et d’assurer un niveau suffisant de financement dans l’éducation et la recherche. Quant à la préservation de l’État de droit, elle devient indispensable à la prospérité économique d’Israël.
Notes
(1) Central Bureau of Statistics, Israel’s National Accounts 2023, Jerusalem, 2024.
(2) Central Bureau of Statistics, Statistical Abstract of Israel 2022, Jerusalem, 2023.
(3) Central Bureau of Statistics, Israel’s National Accounts 2024, Jerusalem, 2025.
(4) OCDE, Statistiques des recettes publiques 2024, Éditions OCDE, Paris, 2024.
(5) Bank of Israel, « The Monetary Committee decides to leave the interest rate unchanged at 4.5 percent », communiqué de presse, 24 février 2025.
(6) Niza Kasir, Rina Pines, Nethanel Flam, Report on the Dimensions of Poverty and Income Inequality 2023, The National Insurance Institute, Jerusalem, 2024.
(7) Central Bureau of Statistics, « Population of Israel on the Eve of 2024 », communiqué de presse, 31 décembre 2024, Jerusalem.
(8) OCDE, Perspectives économiques de l’OCDE, volume 2024, numéro 2, Éditions OCDE, Paris, décembre 2024.