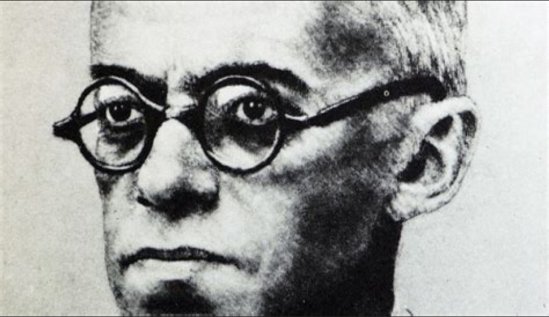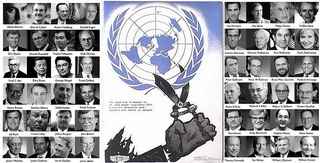Critique littéraire : « Jabotinsky » par Hillel Halkin Douglas J. Feith
Dénoncé par David Ben Gourion comme étant « Vladimir Hitler », Jabotinsky est le sioniste le plus incompris de l’histoire.
Vladimir Jabotinsky, l’ancêtre intellectuel de la droite laïque israélienne, est la figure la plus dénigrée et la plus mal interprétée de l’histoire sioniste. Jusqu’à sa mort en 1940, huit ans avant la naissance de l’État d’Israël, Jabotinsky était le principal rival politique de David Ben Gourion, le leader sioniste travailliste qui devint le premier Premier ministre de l’État juif. Ben Gourion le surnommait « Vladimir Hitler » et le dénonçait, lui et ses partisans, comme des extrémistes et des militaristes qui « éduquent leur jeunesse à tuer ». Inventées il y a 80 ans à des fins politiques sionistes internes, ces calomnies sont aujourd’hui devenues des insultes courantes utilisées par les antisionistes pour dénigrer l’État juif.
La droite domine la politique démocratique israélienne depuis 1977, date à laquelle Menahem Begin, disciple de Jabotinsky et membre du Likoud, est devenu le premier Premier ministre non socialiste du pays. Mais la réputation de Jabotinsky n’a toujours pas été réhabilitée. Le nuage que ses rivaux contemporains ont jeté sur lui et son parti politique, qui a évolué pour devenir le Likoud actuel, ne s’est jamais complètement dissipé. Pour comprendre l’Israël contemporain, il faut apprécier sa pensée politique conservatrice au-delà des insultes. Cela signifie prendre Jabotinsky au sérieux, ce qui est un plaisir, notamment parce que ses nombreux écrits étaient prémonitoires, humains, habiles et souvent humoristiques.
Dans sa biographie captivante et intelligente, Hillel Halkin, lui-même brillant homme de lettres sioniste – traducteur, romancier et essayiste –, met en lumière la nature multiforme de Jabotinsky en tant qu’homme de lettres et polémiste, penseur politique et activiste, père de famille et homme politique frustré. M. Halkin s’intéresse particulièrement à la tension entre la défense passionnée et constante de la liberté individuelle par Jabotinsky et son nationalisme juif fervent, son exaltation de la discipline militaire et sa ligne dure envers les Arabes.
Né en 1880 dans la ville cosmopolite d’Odessa, la seule grande ville russe où les Juifs vivaient librement, Jabotinsky était laïc et sophistiqué. Bien que son père soit décédé lorsqu’il avait six ans et que sa mère gagnait modestement sa vie en tenant une papeterie, Jabotinsky a eu une enfance heureuse, pendant laquelle il faisait l’école buissonnière et des farces, mais il avait un talent pour les mots. À l’adolescence, il était déjà un journaliste prometteur, ayant décroché un emploi dans un journal en impressionnant un rédacteur en chef avec sa traduction en russe du poème « Le Corbeau » de Poe.
Le sionisme offrait une nouvelle réponse à la question juive : que faire du statut des Juifs, considérés comme des hôtes indésirables dans les pays étrangers ? Jabotinsky comprit que les Juifs d’Europe de l’Est menaient une vie misérable — « toujours en état de guerre », comme il l’écrivit dans ses mémoires —, entourés de voisins qui les haïssaient généralement et les frappaient, les violaient et les tuaient sporadiquement lors de pogroms que les autorités toléraient souvent et encourageaient parfois. Il en conclut que l’assimilationnisme juif échouerait et que les sionistes avaient raison : les Juifs avaient besoin d’un État où ils pourraient être majoritaires, gouverner et assurer leur sécurité. Et seule l’ancienne patrie des Juifs, c’est-à-dire Sion, pouvait attirer suffisamment de Juifs et inspirer les efforts nécessaires à la création de ce nouvel État.
La vulnérabilité, les faux espoirs et la complaisance des Juifs de la diaspora mettaient Jabotinsky en rage. Dans une pièce qu’il a écrite en 1907, un sioniste met en garde : « Vous êtes dans la fosse aux lions. Ne vous faites pas d’illusions. Vos rêves ne sont que des élucubrations d’imbéciles. Au bord du volcan, vous n’êtes que des lucioles. » La « servilité » de ses compatriotes juifs face au danger, dit le sioniste, l’a tellement bouleversé qu’il « ne pouvait plus respirer ».
Jabotinsky, selon M. Halkin, aurait pu connaître le succès en tant que dramaturge, journaliste, poète, romancier et orateur. Ses compétences linguistiques étaient étonnantes. Bien que sa langue maternelle fût le russe, il parlait couramment le yiddish, l’hébreu, l’anglais et l’italien. M. Halkin considère son livre « Les Cinq » comme « l’un des meilleurs romans russes du XXe siècle ». Selon le romancier Arthur Koestler, Jabotinsky pouvait « captiver son auditoire pendant trois heures » lorsqu’il donnait des conférences. Le diplomate russe K.D. Nabokov (oncle du romancier) qualifiait Jabotinsky de meilleur orateur de Russie. Mais Jabotinsky abandonna sa carrière littéraire prometteuse pour consacrer sa vie à la promotion d’un État à majorité juive en Terre d’Israël, une région sous domination turque depuis 1517.
Jabotinsky participa à des congrès sionistes, édita des périodiques sionistes et, en 1908, se rendit pour la première fois en Terre Sainte. Là-bas, il entendit des Juifs prédire que les Arabes accepteraient un jour le sionisme. Pourquoi ? Parce que l’immigration juive stimulait l’économie pour tous. Ou, comme le croyaient de nombreux sionistes de gauche, parce que les travailleurs arabes, par solidarité, soutiendraient les Juifs dans la construction d’une communauté socialiste. Jabotinsky rejeta tout cela comme étant irréaliste. « Le nationalisme arabe en était encore à ses débuts, mais il était convaincu qu’un conflit futur avec celui-ci était inévitable », note M. Halkin.
Les Turcs se sont rangés du côté des Allemands lors de la Grande Guerre en 1914, et Jabotinsky était convaincu que la Grande-Bretagne vaincrait la Turquie et prendrait le contrôle de la Palestine. Il décida alors de former une unité militaire juive pour aider la Grande-Bretagne. Son objectif, comme il l’écrivait avec une impressionnante clairvoyance à un autre sioniste en 1915, était de garantir au peuple juif une voix « lorsqu’un jour une conférence de paix sera convoquée [et] que l’un des points à l’ordre du jour sera le démembrement de la Turquie ».
La simple conception de la Légion juive était un coup de génie. Le monde n’avait pas vu de force militaire juive depuis près de 2 000 ans. Pour la créer, Jabotinsky dut surmonter la réticence britannique et l’opposition brutale des dirigeants du mouvement sioniste, qui n’étaient pas enclins à la guerre et avaient de toute façon décidé de rester neutres dans le conflit. Il fallut plus de deux ans de persévérance obstinée avant que la Grande-Bretagne n’accepte la création d’une Légion juive. Jabotinsky s’y engagea, avec quelque 5 000 autres personnes, et ils contribuèrent à libérer la Terre Sainte — 87 légionnaires y perdirent la vie. Mark Sykes et Leo Amery, deux responsables britanniques qui coopéraient avec Jabotinsky et admiraient ses efforts acharnés pour aider la Grande-Bretagne dans son effort de guerre, contribuèrent ensuite à la rédaction de la déclaration Balfour, qui engageait la Grande-Bretagne à soutenir la création d’un « foyer national » juif en Palestine.
En 1920, comme le raconte M. Halkin, Jabotinsky, un officier de la Légion « doté d’une expérience du combat et réputé pour sa détermination », fit appel à d’autres vétérans de la Légion pour créer la Haganah (mot hébreu signifiant « défense »), la première force de sécurité juive à Jérusalem. Elle allait devenir la principale armée juive clandestine de Palestine pendant la période du mandat britannique (1923-1948) et fut à l’origine des Forces de défense israéliennes actuelles.
Dans les années 1920, Ben Gourion et d’autres dirigeants sionistes approuvèrent la création de petites milices juives, mais rejetèrent les propositions militaristes de Jabotinsky visant à créer une armée juive professionnelle. Beaucoup d’entre eux considéraient le combat avec horreur, comme quelque chose que seuls les non-juifs pratiquaient. Mais Jabotinsky voyait le monde comme un cauchemar hobbesien pour ceux qui ne pouvaient se défendre contre leurs ennemis. Il était déterminé à choquer les Juifs afin qu’ils comprennent la nécessité pour leurs jeunes d’acquérir des compétences militaires et de la discipline, afin de retrouver la culture guerrière féroce des armées de David, Salomon et des Maccabées. C’est pourquoi il louait le soldat juif qui disait être « martelé pour devenir ce dont la machine de la nation a besoin » et qui déclarait face au danger national : « Je n’ai même pas de nom. Je suis l’idée du service pur ». C’est ce genre de rhétorique, observe M. Halkin, qui a conduit les critiques à dénoncer Jabotinsky comme un fasciste. En 1933, peu après l’arrivée au pouvoir des nazis, Ben Gourion a déclaré dans un discours qu’il ne serait pas surpris si Jabotinsky « devenait demain l’allié d’Hitler ».
En désaccord permanent avec nombre de ses camarades sionistes, Jabotinsky fonda un nouveau parti politique, les révisionnistes sionistes. Il s’opposait au collectivisme et prônait la liberté individuelle : « Il vaut mieux que l’individu pèche contre la société plutôt que la société pèche contre l’individu ; la société a été créée pour le bien des individus, et non l’inverse », écrivait-il dans un essai publié en 1935. D’autres leaders sionistes se sont interrogés sur la nature idéale de l’État juif : serait-il socialiste ? Occidental ? Laïc ? Mais pour Jabotinsky, la question primordiale était simplement de le faire naître. « Hanté par ce qu’il appelait [...] « la catastrophe imminente dans notre ghetto mondial », il en était venu à considérer le sionisme comme une course contre la montre », écrit M. Halkin. Alors que les nazis renforçaient leur pouvoir, Jabotinsky écrivait dans une lettre adressée à Ben Gourion en 1935 :
Je peux garantir qu’il existe un type de sioniste qui se moque du type de société que notre « État » aura ; je suis cette personne. Si je savais que le socialisme était le seul moyen de créer un État, ou même que cela permettrait de l’accélérer d’une génération, je m’en réjouirais. Plus encore : donnez-moi un État religieusement orthodoxe dans lequel je serais obligé de manger du poisson farci toute la journée (mais seulement s’il n’y avait pas d’autre moyen) et je l’accepterai. Plus encore : faites-en un État où l’on parle yiddish, ce qui pour moi signifierait la perte de toute la magie de la chose — s’il n’y a pas d’autre moyen, je l’accepterai aussi.
Dans son essai le plus célèbre, « Le mur de fer » (1923), il mettait en garde contre l’idée que les Arabes « sont soit des imbéciles, que nous pouvons tromper en masquant nos véritables objectifs, soit des êtres corrompus, que nous pouvons soudoyer pour qu’ils renoncent à leurs revendications prioritaires en Palestine, en échange d’avantages culturels et économiques ». Les Juifs devraient respecter le sérieux du nationalisme arabe, affirmait-il, et reconnaître qu’ils ne feraient jamais la paix avec le sionisme s’ils conservaient le moindre espoir d’éliminer les Juifs de leur terre.
Jabotinsky s’était engagé à défendre les droits individuels des Arabes dans l’État à majorité juive. En effet, lorsque les responsables britanniques ont proposé, à la fin des années 1930, de partitionner la Palestine et de transférer les Arabes hors de la partie juive, les principaux sionistes de gauche ont donné leur accord, mais Jabotinsky a déclaré que « forcer les Arabes à quitter la Palestine était totalement hors de question ». Il a rejeté la proposition, la qualifiant de violation inadmissible des droits individuels des Arabes. Il fit remarquer que les Arabes jouissaient de droits majoritaires dans de nombreux pays et préféreraient bien sûr rester majoritaires en Palestine. Mais ils devront vivre en tant que minorité dans ce pays, dit-il, sinon les Juifs devront vivre en tant que minorité partout dans le monde.
Le défi le plus difficile pour les principes libéraux de Jabotinsky, note M. Halkin, s’est produit pendant la révolte arabe palestinienne à la fin des années 1930, qui a donné lieu à une série d’attaques terroristes contre les Juifs. Ses partisans en Palestine avaient formé un nouveau groupe militaire clandestin connu sous le nom d’Irgoun et se demandaient s’ils devaient combattre le terrorisme par le terrorisme. Jabotinsky a répondu à plusieurs reprises par la négative. « Je ne vois rien d’héroïque à tirer dans le dos d’un paysan arabe qui apporte des légumes à Tel-Aviv sur son âne », cite M. Halkin. Jabotinsky a toutefois fini par conclure que, dans les circonstances terribles du terrorisme arabe persistant qui menaçait les Juifs de la région, il ne pouvait pas refuser à son peuple le droit de riposter pour tenter de vaincre ou de dissuader l’ennemi. M. Halkin souligne les implications douloureuses de ce changement. Mais reconnaissant que l’un des pires effets du terrorisme est de créer un chaos philosophique, il s’abstient de porter un jugement et écrit : « Le calcul moral capable de résoudre de telles équations reste encore à inventer. »
Il existe deux autres biographies remarquables de Jabotinsky, l’une écrite par Joseph B. Schechtman, « The Jabotinsky Story » (1956, 1961), et l’autre par Shmuel Katz, « Lone Wolf » (1996) ; la première compte 1 000 pages, la seconde 1 800. Le livre de M. Halkin dresse un portrait riche en 230 pages. Présentant Jabotinsky comme un penseur moral clairvoyant et profond, M. Halkin le place à la croisée de la philosophie et de l’action politique pratique. Il nous aide à comprendre pourquoi Jabotinsky était craint par ses adversaires sionistes socialistes, mais aussi pourquoi leurs attaques contre lui, le qualifiant d’extrémiste et de militariste, étaient tout à fait injustifiées.
Jabotinsky est mort en 1940 aux États-Unis, où il espérait, avant l’entrée en guerre des États-Unis, former une force de combat juive pour aider la Grande-Bretagne contre les nazis. En Israël, sa pensée reste influente à ce jour, même si la plupart des Israéliens n’ont qu’une vague idée de ce qu’il représentait réellement. Les gauchistes continuent de le vilipender en le qualifiant d’extrémiste de droite, ce qu’il n’était pas. Et certains droitiers qui le vénèrent pensent qu’il serait favorable à l’annexion de la Cisjordanie, mais pas à l’octroi de la citoyenneté aux Arabes qui y vivent. Ce n’est pas le cas. Comme c’est le cas aux États-Unis, Israël compte de nombreuses personnes dont la bonté semble les empêcher de voir clairement le mal dans le monde. Et il y en a beaucoup qui sont tellement sensibles aux menaces que leur vision du monde devient égoïste et brutale. Jabotinsky est l’antidote à ces deux maux. Le livre de M. Halkin le présente dans toute sa complexité, à la fois réaliste et humaine.
Pour prolonger la lecture de cet article lisez Aux origines de la pensée de M. Nétanyahou