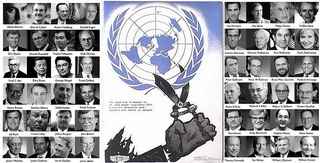ROSA BROOKS
Novembre 2013
Après une série d’articles publiés cet été faisant état de tensions entre le président Barack Obama et ses principaux commandants militaires au sujet d’une éventuelle intervention américaine en Syrie, le chef de cabinet de la Maison Blanche, Denis McDonough, s’est empressé de rassurer le Washington Post en affirmant que tout allait bien : Le président « apprécie » les conseils militaires francs « par-dessus tout », a insisté M. McDonough, et entretient « des relations étroites, et dans certains cas chaleureuses, avec ses chefs militaires », comme l’a écrit le Post. Pendant mon séjour au Pentagone, où j’ai travaillé comme collaborateur nommé par Obama du printemps 2009 à la mi-2011, peu de gens semblaient partager cet avis. Je me souviens avoir demandé à un général, récemment rentré d’Afghanistan, s’il avait partagé ses expériences et ses réflexions avec le président. En roulant des yeux, il m’a répondu d’un ton sombre que la Maison Blanche préférait que les militaires soient vus mais pas entendus.
Curieux de savoir si les choses avaient changé depuis lors, j’ai demandé à une douzaine d’officiers supérieurs en service ou récemment retraités ayant un accès privilégié à la Maison Blanche, dont beaucoup n’étaient pas à l’aise pour s’exprimer officiellement, s’ils connaissaient des chefs militaires avec lesquels le président entretenait une relation personnelle étroite et chaleureuse. Dans tous les cas, la première réaction a été un long silence. « C’est une excellente question », a déclaré un officier supérieur à la retraite, après une longue pause. « Bonne question. Je ne sais pas », a déclaré un deuxième. « Je ne pense pas qu’il soit proche de qui que ce soit », a commenté un troisième. Il ne semble tout simplement pas intéressé par le fait de « connaître » l’armée, a conclu un général à la retraite.
Bien sûr, aucune loi n’oblige le président à inviter ses généraux les plus haut gradés à des soirées pyjama ou à des parties de golf, et être « proche » des chefs militaires ne garantit pas une prise de décision judicieuse. Mais tout cela soulève une question de plus en plus pertinente : comment le président – l’homme qui a promis de « terminer le travail » en Afghanistan, de mettre fin à la guerre impopulaire en Irak et de « mettre fin à la mentalité qui nous a conduits à la guerre au départ » – a-t-il géré une armée qu’il semble souvent considérer avec méfiance et inquiétude ?
« Les Américains sont profondément ambivalents à l’égard de la guerre », a déclaré Obama devant un auditoire de l’Université nationale de défense en mai. Il aurait pu parler de lui-même. Malgré ses promesses électorales, Obama s’est engagé dans une série d’aventures militaires, dont certaines sont de son propre fait. Bien que les dernières troupes américaines se soient finalement retirées d’Irak en décembre 2011, il y a aujourd’hui près de deux fois plus de soldats américains en Afghanistan qu’au moment de la première élection d’Obama. Obama a également présidé une campagne aérienne de sept mois en Libye et accéléré une guerre secrète menée à l’aide de drones qui a jusqu’à présent tué environ 4 000 personnes au Pakistan, en Somalie et au Yémen. Malgré tout cela, le président a continué d’exprimer sa consternation face à la politique étrangère militarisée de son pays : « Nous ne pouvons pas recourir à la force partout », a-t-il insisté en mai. « Une guerre perpétuelle [...] s’avérera contre-productive et modifiera notre pays de manière inquiétante. »
Après plus d’une décennie de combats, de nombreux chefs militaires partagent les préoccupations d’Obama concernant le coût d’une guerre perpétuelle. Mais la plupart des personnes interrogées pour cet article – un groupe d’actuels et d’anciens hauts responsables du Pentagone qui ont collectivement dirigé bon nombre des guerres menées sous le mandat d’Obama – ont également exprimé leur crainte que l’ambivalence du président à l’égard de la force militaire ne se soit transformée en ambivalence à l’égard de l’armée elle-même. Les généraux m’ont confié qu’ils pensaient que cette double ambivalence avait contribué à une série de décisions stratégiquement incohérentes de la Maison Blanche et, malgré les assurances de McDonough, la plupart de mes sources ont déclaré que les tensions entre la Maison Blanche et l’armée étaient inquiétantes.
La dernière cause des aigreurs d’estomac au sein du Pentagone est sans aucun doute la Syrie. Le 21 août, selon les États-Unis et leurs alliés, les forces du dirigeant syrien Bachar al-Assad ont lancé une attaque chimique contre une zone contrôlée par les rebelles, franchissant ainsi la « ligne rouge » tracée par Obama. Ce dernier a réagi en déclarant son intention d’« envoyer un message » à Assad par le biais de frappes militaires ciblées.
Le moment était mal choisi. Quelques jours seulement avant l’attaque chimique, le général Martin Dempsey, président du Comité des chefs d’état-major, avait publiquement rejeté l’idée d’une intervention militaire américaine en Syrie, soulignant le risque d’escalade, l’importance d’être « réaliste quant au coût en vies humaines et en ressources financières » et « les limites de la force militaire ». Dempsey s’est montré plus circonspect lors de son témoignage devant le Congrès, mais « son langage corporel », selon le major général à la retraite Paul Eaton, suggérait toujours qu’il pensait : « Je n’arrive pas à croire à quel point c’est stupide ».
L’ancien secrétaire à la Défense Robert Gates s’est montré explicitement critique dans un discours prononcé en septembre : « Je pense que faire exploser un tas de choses en quelques jours pour souligner ou valider un point ou un principe n’est pas une stratégie. »
Selon la plupart des personnes que j’ai interrogées, les propos cinglants de Gates reflètent un mécontentement largement partagé au sein de l’armée à l’égard du commandant en chef. « L’armée n’apprécie guère que l’on lui demande de faire des choses sans y avoir mûrement réfléchi », observe Eaton. « Les militaires sont quelque peu perplexes lorsque des civils leur disent qu’il est acceptable de réduire des gens en miettes à l’aide de bombes, tant qu’on ne les tue pas avec des armes chimiques. »
« Aucun soldat sensé ne garantirait l’absence de troupes au sol », m’a confié avec frustration un autre commandant supérieur à la retraite, après que le président eut promis exactement cela. « On ne peut jamais donner de telles garanties. Et nous devons faire attention à la manière dont nous établissons des limites morales et des distinctions dans cette guerre civile terriblement compliquée. En 12 ans de guerre, les États-Unis ont tout gagné sur le plan tactique et rien sur le plan stratégique. Ne bombardons pas quelqu’un juste pour le plaisir de le bombarder. »
L’épisode syrien a renforcé le sentiment d’une crise dans les relations entre la Maison Blanche et le Pentagone, et les médias se sont empressés d’attiser la controverse. « Les généraux américains sont furieux et ne sont plus disposés à accepter cette situation », titrait Foreign Policy. Le Washington Post a publié une tribune libre cinglante du major général à la retraite (et commentateur sur Fox News) Robert Scales, qui affirmait que les militaires étaient « embarrassés d’être associés à l’amateurisme des tentatives de l’administration Obama pour élaborer un plan stratégiquement sensé ».
Elizabeth Sherwood-Randall, coordinatrice de la politique de défense à la Maison Blanche, m’a assuré dans un communiqué envoyé par courrier électronique que le président « s’appuie fortement » sur ses hauts responsables militaires pour obtenir « des conseils francs et directs sur le moment et la manière d’utiliser la force militaire pour atteindre nos objectifs de sécurité nationale ». Cependant, lors de mes entretiens, de nombreux hauts responsables militaires se sont plaints de se sentir déconcertés et exclus par le personnel de la sécurité nationale de la Maison Blanche qui, selon eux, combine une insistance à microgérer des questions mineures avec une incapacité quasi totale à articuler des objectifs stratégiques cohérents. « Le NSS veut diriger les opérations, jour après jour et minute après minute », déplore un ancien responsable militaire, « de sorte qu’ils n’ont pas le temps — ils sont presque incapables de réflexion stratégique ».
Faisant allusion à la célèbre maxime de Carl von Clausewitz, un autre général supérieur récemment retraité a exprimé une frustration similaire. « Si la guerre est « la continuation de la politique », j’aimerais savoir quelle est cette politique, afin d’éviter de la gâcher ou de gaspiller des vies sans raison. » Mais, dit-il, « je ne comprends pas le processus par lequel la Maison Blanche prend ses décisions stratégiques ou de politique étrangère. ... Il y a une apparence de consultation, mais vous savez que vous ne serez pas écouté. »
Y a-t-il eu un moment précis où les relations entre Obama et l’armée ont commencé à se détériorer ? La plupart des observateurs pointent du doigt les débats houleux de 2009 sur le nombre de soldats en Afghanistan.
Immédiatement après son investiture en 2009, Obama s’est engagé à tenir sa promesse de « terminer le travail » en Afghanistan. Il a commandé une révision approfondie de la politique américaine et a annoncé qu’il avait autorisé le déploiement provisoire de 17 000 soldats américains supplémentaires en réponse à la demande du commandant du théâtre d’opérations, le général David McKiernan.
À la fin du mois de février 2009, le président avait adopté les nouveaux objectifs stratégiques recommandés par son équipe d’évaluation interagences : désormais, les États-Unis mettraient l’accent sur la lutte contre Al-Qaïda et renforceraient les forces de sécurité militaires afghanes. Mais à la mi-mai, McKiernan, le premier des nombreux commandants du théâtre afghan sous Obama à découvrir à quel point il serait difficile de « mener à bien la tâche », avait été limogé. « La guerre est un auditeur sévère », m’a confié le général à la retraite James Mattis, ancien membre du Corps des Marines. Tous les commandants ne sont pas à la hauteur.
McKiernan a été remplacé par le général Stanley McChrystal, qui a à son tour été chargé de mener sa propre évaluation sur 60 jours. Mais lorsque la rumeur s’est répandue que McChrystal avait l’intention de proposer une nouvelle augmentation substantielle des effectifs, que les ragots du Pentagone estimaient initialement à 80 000 soldats supplémentaires, une vague de consternation a déferlé sur la Maison Blanche. Fin septembre 2009, une copie de l’évaluation de McChrystal a été divulguée au Washington Post. Sa conclusion était claire : si les États-Unis n’injectaient pas rapidement des ressources supplémentaires importantes en Afghanistan, le résultat probable serait un « échec de la mission ».
« Je ne pense pas qu’Obama ait vraiment réalisé que nous étions en train de perdre la guerre en Afghanistan avant la fin de l’année 2009 », m’a confié un général de l’armée à la retraite ayant une grande expérience de l’Afghanistan. Furieux de cette fuite, qu’ils attribuaient au Pentagone, et réticents à accepter les conclusions pessimistes de McChrystal, les hauts responsables de la Maison Blanche se sont livrés à des contre-fuites stratégiques. Selon leur version, McChrystal et le Pentagone tentaient de coincer le président en faisant pression pour déployer des dizaines de milliers de soldats supplémentaires et en refusant d’envisager d’autres approches.
Après des mois de réunions de plus en plus tendues, Obama a pris une décision : 30 000 soldats américains supplémentaires seraient envoyés en Afghanistan, mais après 18 mois, ces troupes commenceraient à se retirer. Et l’armée ne serait pas laissée seule pour résoudre tous les problèmes, a promis le président ; une « stratégie civile plus efficace » favoriserait l’amélioration de la gouvernance et du développement économique en Afghanistan. (La « poussée civile » du président ne s’est jamais vraiment concrétisée. Dans son livre Little America : The War Within the War for Afghanistan, Rajiv Chandrasekaran cite la réplique sarcastique du brigadier général Kenneth Dahl en 2011 à Karl Eikenberry, alors ambassadeur des États-Unis en Afghanistan, qui avait déclaré que la poussée civile avait atteint « son point culminant ». « C’est formidable, a répondu Dahl. Je la sens lécher mes chevilles. »)
À la suite de la décision du président, j’ai vu des responsables civils et militaires travailler loyalement pour présenter sous le meilleur jour possible un compromis qui, en réalité, ne satisfaisait pleinement personne. « La Maison Blanche était convaincue que l’armée avait tout intérêt à aggraver le conflit », explique un ancien responsable de la Maison Blanche. « Ils se sentaient manipulés. » Et moins d’un an plus tard, McChrystal a été contraint de démissionner après qu’un article du magazine Rolling Stone ait cité ses principaux collaborateurs militaires se moquant de plusieurs hauts responsables civils, dont Eikenberry et le vice-président Joe Biden.
Pour la Maison Blanche, la leçon à retenir était de prendre les conseils militaires avec beaucoup de prudence. Les anciens responsables de la Maison Blanche avec lesquels je me suis entretenu partageaient généralement l’avis des généraux quant aux préoccupations et à la méfiance mutuelle qui caractérisaient leurs relations. Obama « est désormais moins déférent envers l’armée », ajoute un membre du personnel du Sénat familier avec ces débats. « Il existe une méfiance implicite. »
Le point de vue du Pentagone sur le débat concernant l’Afghanistan était assez différent.
« La position générale [de l’armée] est la suivante : « Nous pouvons le faire, mais nous voulons que vous reconnaissiez le chaos, le coût et la complexité de la situation » », explique un ancien haut responsable du Pentagone. Pour de nombreux militaires, les recommandations de McChrystal en 2009 concernant les troupes ont été victimes d’une Maison Blanche refusant de reconnaître ces éléments. « On a l’impression que la Maison Blanche veut des choses contradictoires, impossibles... mais ne veut pas les financer », m’a confié un membre du personnel du Congrès ayant une expérience militaire.
En effet, la plupart des chefs militaires que j’ai interrogés ont déclaré qu’ils pensaient que les recommandations militaires étaient souvent ignorées par les hauts responsables de la Maison Blanche, qui partent désormais du principe que le Pentagone, peu enclin à prendre des risques, exagère toutes les difficultés et gonfle toutes les demandes de troupes ou de fonds.
Cette hypothèse transforme les discussions en séances de négociation antagonistes. Comme le dit un général à la retraite : « Si vous dites : « Nous avons besoin de 40 000 soldats », ils répondent immédiatement : « 20 000 ». Non pas parce qu’ils pensent que c’est le bon nombre, mais simplement parce qu’ils considèrent comme acquis que tout chiffre avancé par l’armée est exagéré. »
« Parfois, on a envie de leur dire : « Ce n’est pas un processus de négociation politique » », déclare avec regret un autre haut responsable militaire à la retraite. « Lorsque l’armée demande beaucoup, ils proposent peu, et nous nous mettons d’accord sur une option qui fait la moyenne. Inutile de dire que la bonne réponse ne se trouve pas toujours au milieu. »
Un ancien responsable de la Maison Blanche ayant travaillé au Pentagone affirme que le personnel de la Maison Blanche reste souvent volontairement ignorant de la logique qui sous-tend les recommandations militaires : « Ils ne veulent pas prendre le temps d’examiner les diapositives ou d’assister à l’intégralité du briefing. En gros, ils ne veulent pas savoir. »
Au fil du temps, bien sûr, la tendance de la Maison Blanche à faire des compromis ne peut que créer des incitations perverses pour les planificateurs militaires, renforçant ainsi la méfiance mutuelle. « Si vous pensez que la mission nécessite réellement 50 000 soldats et 50 milliards de dollars, mais que vous savez que la Maison Blanche va automatiquement réduire chaque chiffre de moitié, vous demanderez 100 000 soldats et 100 milliards de dollars », explique l’ancien fonctionnaire de la Maison Blanche susmentionné. « L’armée finit par jouer le jeu que la Maison Blanche l’a toujours soupçonnée de jouer. »
Les enjeux sont importants, selon l’ancienne sous-secrétaire adjointe à la Défense Kathleen Hicks. Que le sujet apparent soit l’Afghanistan ou la Syrie, « le contexte est en réalité celui des tensions autour des budgets et de l’argent. Les hauts responsables militaires s’inquiètent de devoir accomplir toutes ces tâches [différentes], mais qui va les financer ? Qui veille aux intérêts institutionnels de l’armée ? » Elle ajoute que « la Maison Blanche soupçonne l’armée d’exagérer les problèmes que causeront les coupes budgétaires, ce qui ne fait qu’accroître la frustration des militaires ».
Le lieutenant-général à la retraite James Dubik, vétéran du règne tumultueux de Donald Rumsfeld au département de la Défense, attribue ces malentendus au fossé culturel qui sépare souvent les dirigeants militaires et politiques. Il existe plusieurs modèles de base de relations entre les civils et les militaires, note-t-il. Le premier est le modèle traditionnel de sphères d’autorité distinctes : « Les civils élaborent les politiques ; les militaires les exécutent », mais décident toujours des moyens d’exécution.
Dans un deuxième modèle, « les civils sont les dirigeants, les militaires sont des employés spécialisés. Les militaires peuvent donner des conseils, mais ils doivent faire ce que leur dit leur supérieur, de la manière dont il le souhaite, ni plus ni moins. » Mais, selon Dubik, « la plupart des militaires préfèrent encore le modèle traditionnel de séparation des sphères, tandis que la plupart des membres de la Maison Blanche ont tendance à penser en termes de modèle employeur-employé. C’est la recette du malheur. »
Ce fossé culturel entre le Pentagone et la Maison Blanche semble souvent infranchissable. L’armée est hiérarchisée et structurée ; les organisations civiles, même au sein de la Maison Blanche, sont organisées de manière plus souple. Pour l’armée, la « planification » est un processus méticuleusement défini, conçu pour élaborer des plans d’action réalisables, jusque dans les moindres détails logistiques ; pour les civils, la planification consiste souvent simplement à discuter de ce qui pourrait se passer à l’avenir.
Au cours de mon bref passage au Pentagone, il y a eu de nombreux moments où les responsables de la Maison Blanche et les responsables militaires étaient tellement éloignés les uns des autres qu’ils auraient pu parler des langues différentes, obligeant les civils du ministère de la Défense comme moi à jouer le rôle souvent délicat de traducteurs.
Il y a eu par exemple ce membre du personnel de la Maison Blanche qui m’a appelé pour me demander de faire déplacer un drone américain au Kirghizistan par le CENTCOM, afin de suivre une flambée alarmante de violences ethniques. Lorsque je lui ai expliqué pourquoi je ne pouvais pas le faire (la chaîne de commandement ne fonctionne tout simplement pas ainsi, et de toute façon, aucune planification officielle ni évaluation des risques n’avait été effectuée), il s’est rapidement énervé.
« Vous autres » (le Pentagone) « nous mettez toujours des bâtons dans les roues. Je vous appelle de la Maison Blanche. Le président veut empêcher un génocide au Kirghizistan. Qu’est-il advenu du contrôle civil sur l’armée ? » « Vous », ai-je dû lui dire, « n’êtes pas le bon civil ».
Comme pour souligner le choc culturel, après des épisodes comme celui-ci, la réaction de certains de mes collègues de l’administration Obama à la Maison Blanche était amère : « Est-ce que j’étais passé « dans l’autre camp » ? » m’a demandé l’un d’eux.
L’armée et la Maison Blanche ne sont pas censées être dans des « camps » différents, mais il existe une longue histoire de récriminations mutuelles ; c’est pratiquement une tradition américaine. Rappelons-nous le licenciement théâtral du général Douglas MacArthur par le président Harry Truman au milieu du conflit sur l’escalade de la guerre de Corée ; la condamnation par Dwight Eisenhower du « complexe militaro-industriel » ; les luttes de John F. Kennedy avec les chefs militaires pendant la crise des missiles de Cuba ; et l’échec de Bill Clinton à mettre fin à l’interdiction pour les homosexuels de servir ouvertement dans l’armée. Et ce n’est que dans l’après-guerre.
Dubik affirme que ceux qui critiquent les relations entre Obama et l’armée ont la mémoire courte. « Cette administration semble plus inclusive et plus disposée à écouter que les précédentes », dit-il sèchement. Et, ajoute-t-il, si quelqu’un imagine que les chefs militaires sont plus à l’aise avec les administrations républicaines, « c’est des balivernes ». Charles J. Dunlap, général de division de l’armée de l’air à la retraite depuis 2010, partage cet avis : « Plus on passe de temps dans l’armée, plus on se rend compte qu’il n’y a pas tant de différences entre les administrations. »
Les désaccords entre les chefs militaires et la Maison Blanche peuvent être sains pour une société démocratique. Après tout, les hauts commandants ont l’obligation légale et éthique de fournir au président et au Congrès des conseils militaires honnêtes, et même si les préoccupations ouvertement exprimées par Dempsey au sujet de la Syrie n’ont peut-être pas été bien accueillies par les responsables de la Maison Blanche, selon le lieutenant-général à la retraite David Barno, « le président doit dire : « Voici les risques liés à cette ligne de conduite ».
Quoi qu’il en soit, prévient un autre général à la retraite, la seule chose pire qu’une armée ouvertement dissidente est une armée secrètement dissidente. « Méfiez-vous du silence des généraux », ironise-t-il. « Le silence public ne signifie pas l’inaction privée. » Il est bien préférable, selon lui, que les hauts gradés « s’expriment ouvertement et rendent compte de leurs réflexions » plutôt que de « s’exprimer par l’intermédiaire de mandataires et de manipuler en coulisses ».
Pendant ce temps, le président a « raison de poser des questions difficiles à ses généraux », estime Dunlap. Chaque administration préfère présenter un front uni avec l’armée, mais, comme me l’a dit un autre haut responsable militaire à la retraite, le président doit être à l’aise si cela s’avère impossible : « Il n’y a rien de mal à ce que le président dise : « L’armée voulait quelque chose, mais en tant que président, j’ai pris une décision différente, et voici pourquoi. » Le président ne devrait pas avoir peur de cela. »
C’est plus facile à dire qu’à faire. Pour cette administration, l’armée est le gorille proverbial de 800 livres, plus que jamais. Après les attentats du 11 septembre, les ressources et les pouvoirs ont été généreusement accordés au Pentagone, dont le budget a presque doublé au cours de la décennie suivante. L’administration du président George W. Bush « a toujours voulu que les militaires s’occupent de tous les problèmes », se souvient un général à la retraite qui a occupé des postes de haut niveau pendant cette période. Et Bush était plus que disposé à dépenser l’argent nécessaire pour y parvenir.
Pendant ce temps, les budgets des agences et des programmes civils sont restés largement stagnants. « Il y a dix ou quinze ans, l’armée était beaucoup plus petite et moins holistique », note un autre officier à la retraite. Aujourd’hui, l’armée en fait plus avec plus de moyens : elle sponsorise des émissions de radio et de télévision en Afghanistan, gère des cliniques médicales en Afrique, fournit une assistance technique aux tribunaux et aux parlements, s’engage dans la cyberdéfense, mène des frappes de drones dans des endroits reculés et collecte des données à partir de nos appels téléphoniques et de nos e-mails.
« C’est tout simplement la solution la plus facile à tous les problèmes », explique Eaton. « Donnez de l’argent à l’armée et laissez-la s’en occuper. »
Selon Barno, l’armée américaine, en expansion constante, devient « une sorte de super Walmart où tout est regroupé sous un même toit ». À l’instar de Walmart, l’armée peut mobiliser d’énormes ressources et exploiter des économies d’échelle d’une manière impossible pour les petites entreprises familiales. Et comme Walmart, la commodité séduisante du guichet unique offert par l’armée a un effet dévastateur sur les entreprises plus petites et plus traditionnelles, en l’occurrence les diplomates de Foggy Bottom, qui sont en infériorité numérique. Ou encore la boutique de sécurité nationale de la Maison Blanche, où réside le pouvoir, mais pas les ressources.
Et pourtant, personne, et encore moins Obama, ne semble savoir comment faire face à la « walmartisation » implacable de l’armée. Même si le président est théoriquement déterminé à rééquilibrer les rôles civils et militaires, Obama s’est retrouvé à plusieurs reprises à se tourner vers le Pentagone en temps de crise, que ce soit en Libye, en Syrie ou au Yémen.
Au final, c’est peut-être là la véritable histoire d’Obama et de ses relations difficiles avec une armée qu’il était déterminé à contrôler lorsqu’il est arrivé au pouvoir.
« Quand les choses tournent mal », explique un ancien responsable de la Maison Blanche, « il se précipite à chaque fois vers ce super Walmart ».
Rosa Brooks, professeure de droit à l’université de Georgetown, a été nommée par Obama au ministère de la Défense de 2009 à 2011.